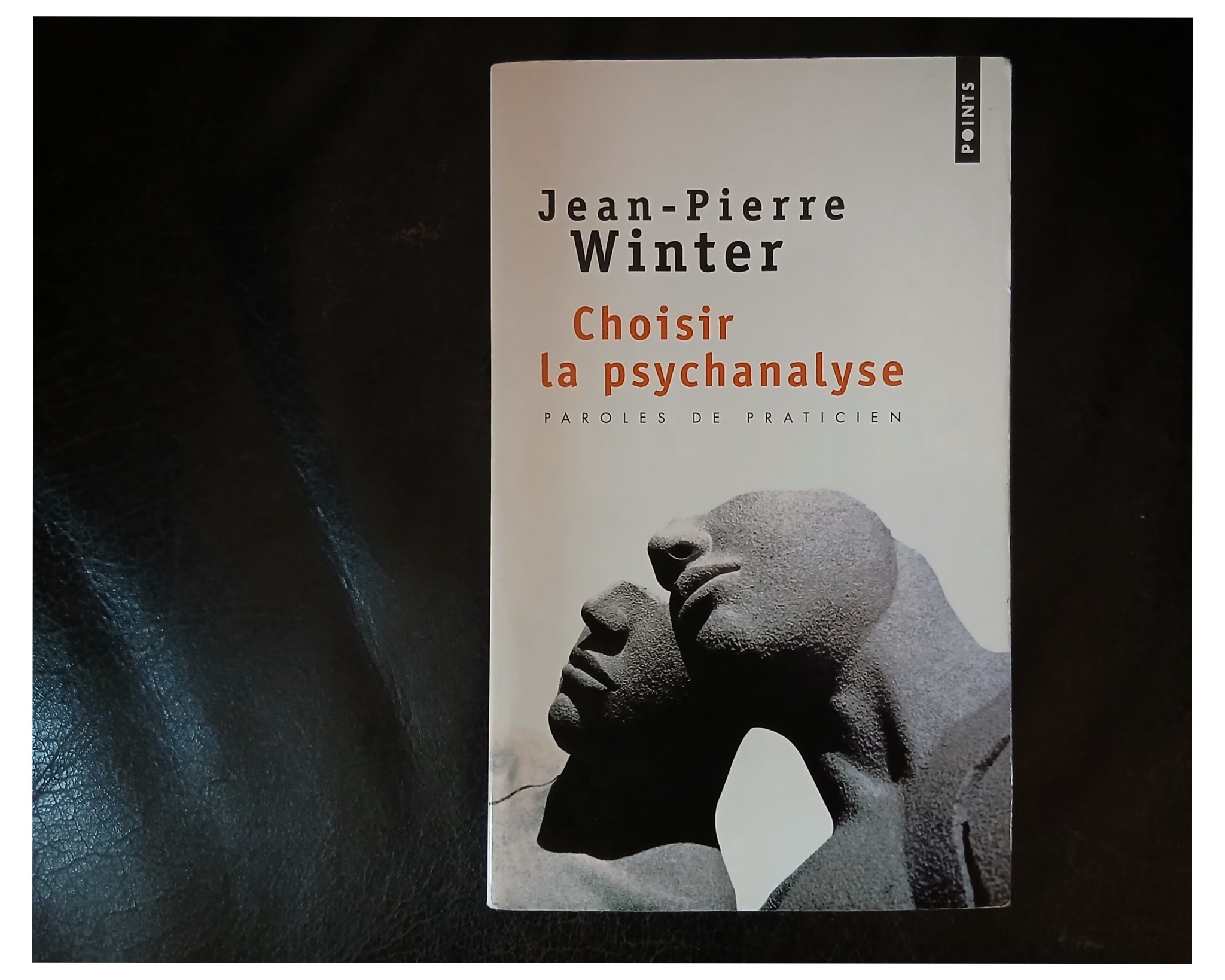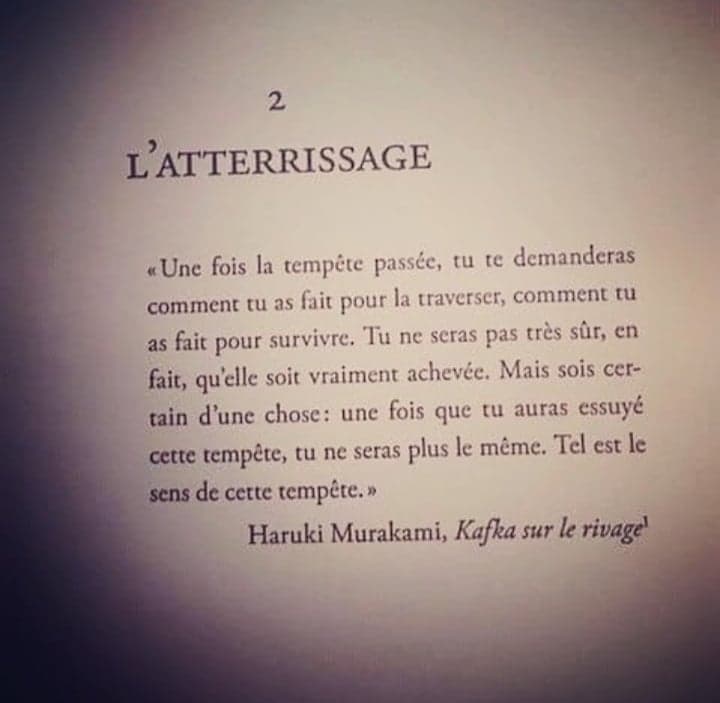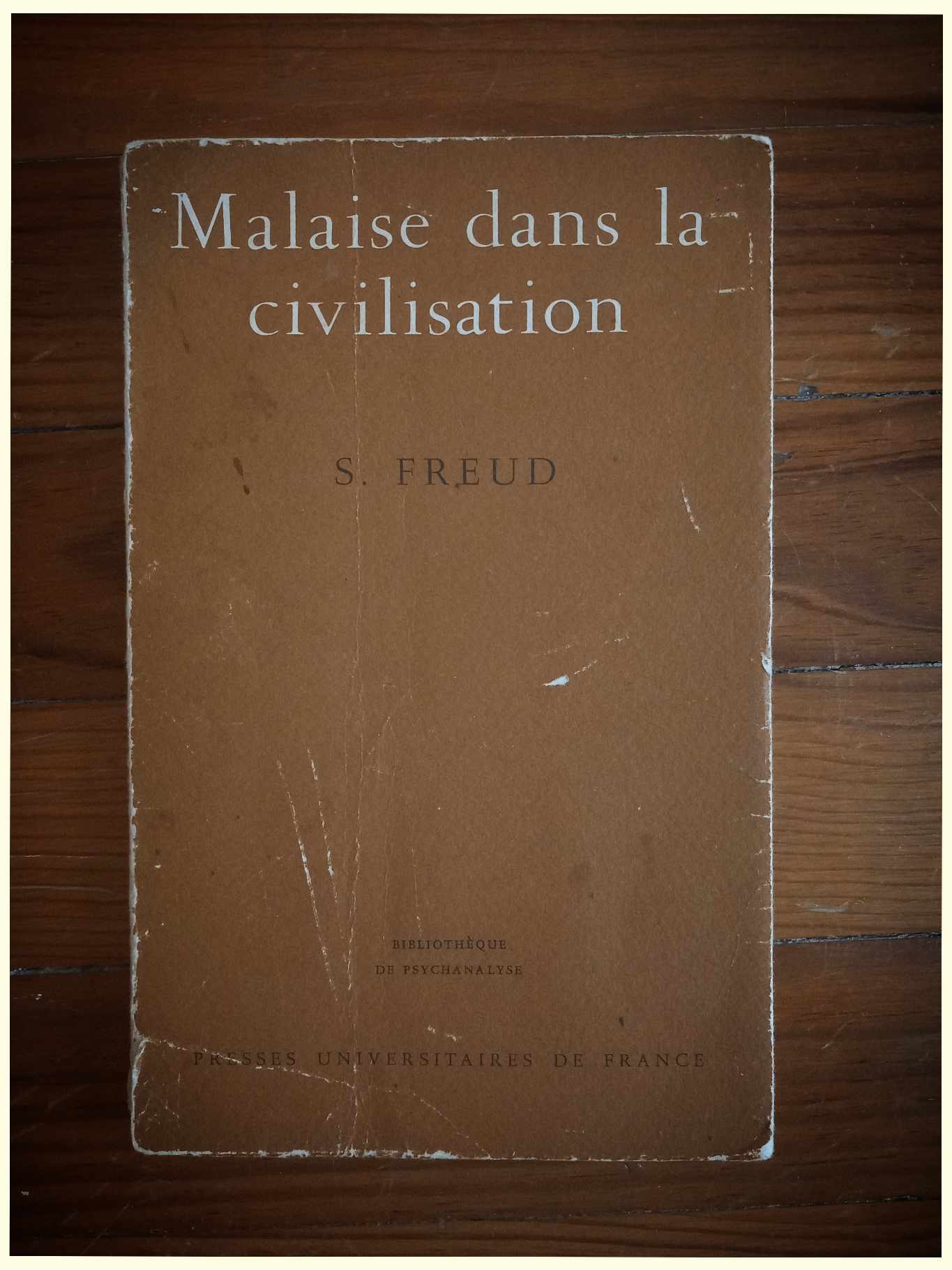Extrait du texte d’Anne Dufourmantelle, Intelligence du rêve, Manuels Payot, 2012, dans lequel l’auteure interroge aussi les figures symboliques de l’ange, du génie poétique et du daimôn, messagers de la parole comme le rêve l’est de notre plus secrète identité.
Aux abords du trauma
Le rêve construit des scénarios dont nous sommes les héros secrets, nous offrant ainsi, en dépit du danger ou grâce à lui, une royauté reconquise. La jeune adolescente au moment de ses règles devrait comprendre qu’il est temps de se séparer de sa mère, de conquérir un espace propre qu’elle ne devra qu’à son courage, sa détermination, sa confiance en la vie aussi. La mélancolie est parfois, dit J-P Winter*, le signe que nous avons abdiqué et que nous le savons ; elle nous hante de ce savoir que nous aurions dû ou pu combattre, au moins nous révolter, et que nous n’en avons pas eu la force. Elle trahit ce silence secret, c’est pourquoi elle est toujours aussi une colère.
Read More