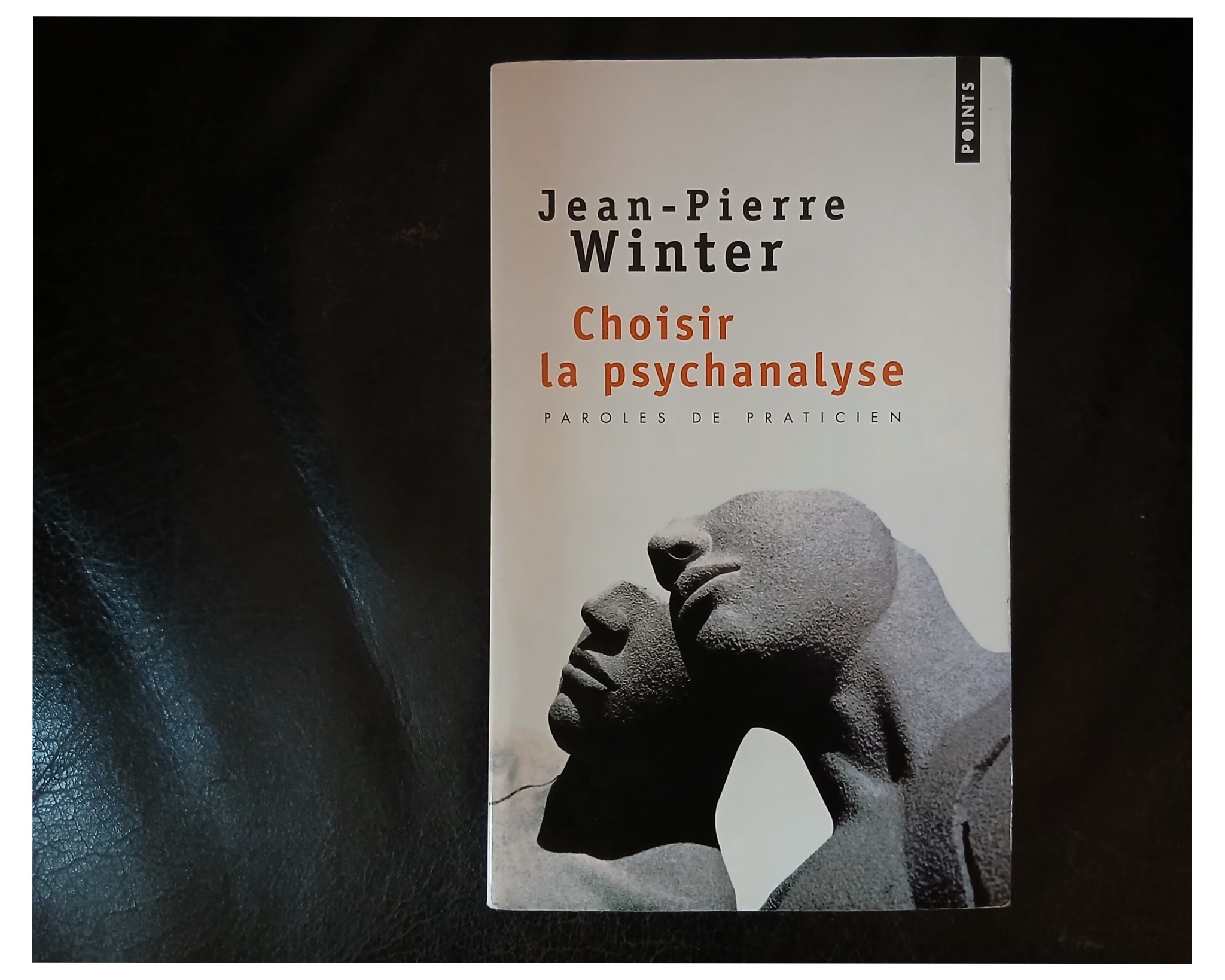
Écoutez un peu !, que j’entende quelque chose.
Freud était un médecin bavard, démonstratif, persuasif. Ce sont des patientes hystériques qui lui ont ordonné de se taire et d’écouter jusqu’au bout ce qu’elles voulaient dire et qu’elles ne savaient pas encore. Ce qu’elles ignoraient, c’est que la sincérité ne suffit pas pour faire vaciller la statue de soi-même que chacun a construite.
Au fur et à mesure que progressait leur parole, elles comprenaient que seul le silence relatif (attentif) de celui à qui elles s’adressaient leur donnait l’opportunité de s’entendre dire autre chose que ce qu’elles croyaient dire.
Silence relatif puisque, à la différence des dieux auxquels les croyants confient leurs prières, l’analyste, même silencieux, ne cesse pas de parler (dire). Il est là, présent dans son corps, avec sa respiration, ses regards, ses ponctuations, ses symptômes et surtout son désir d’analyste.
Tout en parlant, l’analysant n’arrête pas de déchiffrer ce qui, de sa parole, lui revient ou ne lui revient pas de l’autre : un désir énigmatique qui se noue à son désir. Un désir de l’autre que métaphorise le silence de l’analyste et dans lequel, s’il l’affronte, il reconnaîtra son désir.
Chacun est libre de tenter l’aventure, personne ne peut y être contraint, et rien ne garantira jamais qu’à s’y essayer le sujet rencontrera ce qu’il est venu chercher.
Mais justement, c’est de cette liberté que peu de gens veulent. J’en veux pour preuve ces demandes de conseils par lesquelles le sujet avoue que cette liberté de dire sans être interrompu lui est insupportable et qu’il lui préfère la servitude volontaire où il s’en remet à un autre qui le soulage de savoir.
Souvent l’analyste est tenté de quitter la place inconfortable qui est la sienne et, tombant dans le piège qui lui est ainsi tendu, il passe de la position de celui qui est « supposé savoir » à celle du maître qui, lui, sait. Les conséquences peuvent être plus ou moins tragiques mais, à céder trop souvent à cette tentation, il cesse d’être pour le patient un analyste et se transforme, pour le pire et jamais pour le meilleur, en conseiller pédagogique ou conjugal qui éternalise le transfert ou le fait évoluer vers l’ininterprétable. Il arrive que, poussé avec violence (verbale) dans ses ultimes retranchements, l’analyste perde de vue qu’en aucun cas le patient ne souhaite qu’il se fourvoie sur l’adresse de son insistance à le faire choir de sa place ; sans doute à ces instants rencontre-t-il chez lui un désir resté inanalysé. Mais s’il n’oppose aucun obstacle personnel à l’aveu, par son patient, de son désir, c’est in fine la résistance de la parole à dire le désir que le sujet rencontrera. Ce qui est fort différent de la résistance de son analyste. Ainsi, ici reprocher à l’analyste, a priori, son silence, c’est dire la peur d’être libre. Peur bien compréhensible, mais qui sera traitée sans trop de compassion puisque cette liberté n’est rien d’autre que celle de se défaire de ce qui nous encombre et au premier chef de notre goût insatiable pour la dépendance.

