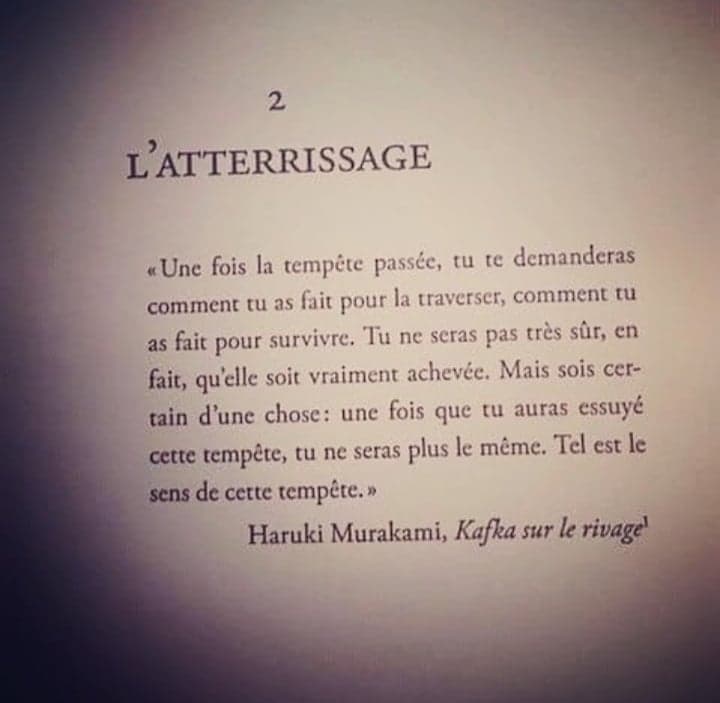
Celui qui pleure est un magicien, un sorcier.
[ … ] Autant dire que pour la psychanalyse, la loi se forge comme Loi dans le réel ; vient du réel. C’est là, me semble-t-il, qu’il y a une hypothèse vraiment nouvelle : il y a une orientation dans le réel. C’est ça notre nouvelle mythologie, plus que l’oedipe devenu un bavardage trop commode. A partir de cette trouvaille, un gros travail de Lacan aura été d’ancrer la psychanalyse dans ce qu’il a appelé l’au-delà de l’oedipe – soit l’entre-deux-morts dont on ne sort que par la production d’une oeuvre : la « suppléance » qui re-nomme l’auteur.
L’oeuvre est ici ce qui répond à l’orientation donnée dans le réel, et cet orient, par définition, n’est pas phallique, puisque nous sommes là dans un im-monde où il n’y a plus de désir. Telle est, du moins, la thèse lacanienne ; je pense qu’elle serait à discuter. Quoi qu’il en soit, on peut aisément se représenter ce que Lacan, prenant appui sur la physique (science du réel) de la température dont il n’y a de limite absolue qu’inférieure, affirme : l’orientation dans le réel est une orientation par le bas. De même qu’il faut parfois toucher le fond pour pouvoir remonter à la surface, la Loi ne se donne en vérité que dans la catastrophe.
Attention cependant à un contresens possible. Je conçois pleinement que cet orient ne soit pas phallique stricto sensu. Mais il n’est pas pour autant a-phallique, bien au contraire, puisqu’il fomente l’émergence possible. C’est ce que j’ai tenté de montrer à propos des larmes. La première larme est une érotisation primaire, création d’objet dans un univers où il n’y a plus d’objets. Celui qui pleure est un magicien, un sorcier.
Je ne comprends pas qu’on puisse être psychanalyste sans avoir défié le ciel, et les dieux, c’est-à-dire sans être allé loyalement vers la castration que le commun des mortels évite avec horreur en se pliant aveuglément aux interdits. Autrement dit, il faut en payer le prix le plus cher, c’est-à-dire le plus chair. Ce prix le plus cher, toute notre clinique nous indique que c’est le chagrin d’amour, prototype de la Hilflosigkeit – soit l’état de détresse.
Supposer qu’il y ait une orientation dans le réel, c’est affronter des questions comme la naissance du pulsionnel. Or, cette question me semble être une des plus insistantes dans ce qui préoccupe et termine la culture aujourd’hui. Prenons l’exemple de la musique. A chaque érotique sa musique. Mais la musique dite « contemporaine », c’est-à-dire la musique la plus élaborée, a un statut différent puisqu’elle s’avère être une musique de création, d’émergence, du pulsionnel lui-même. Evidemment, on peut soutenir que ceci aussi, d’une certaine façon, est une sorte d’érotique. mais j’attire votre attention sur le fait que ceci est alors une érotique nouvelle. – une érotique qui comporte sa propre émergence.
La préoccupation actuelle dans l’avant-garde en art est de plain-pied dans cet au-delà.
Cette mutation assumée par Lacan a répondu à des exigences cliniques. Je suis convaincu que ça a été son guide.
J’en distingue quelques-unes.
C’est un constat banal que dans nombre de cas les constructions et même les interprétations n’affectent pas le patient. Même si elles sont « vraies »… ça ne fait pas croyance, ça ne fait pas certitude. Mais après tout, pourquoi ? Pourquoi c’est moins convaincant que l’hallucination ou l’expérience de la beauté, par exemple ? Parce que le symbolique pur ne suffit pas. Ce constat revient comme une plainte au praticien regagné par les mirages de l’échange moque, et il est bon de rappeler sans cesse aux chantres de la psychologie que leurs espoirs sont vains parce qu’ils nient la dimension de l’inconscient.
Une deuxième exigence clinique, c’est la nécessité de lutter sans cesse contre tout ce qui veut rendre coupable le désir de vivre. Je renvoie ici à tous les débats qui ont agité la communauté psychanalytique à propos de la pulsion de mort (« la vie qui ne veut pas mourir », dit Lacan). De sorte qu’une psychanalyse, c’est ouvrir un espace et un lieu où chacun peut se livrer à ce qu’il a de mieux en lui – pas seulement le pire, et parce qu’il y a aussi le pire. Ceci s’oppose point par point à l’illusion pédagogique, et Freud l’avait parfaitement saisi puisqu’il affirmait que l’éducation ne transmet que le surmoi des parents. Ce que nous permettons est plutôt de l’ordre de l’invention. J’ajouterai aussi que cette illusion s’oppose à la mémoire puisqu’elle confond oubli et refoulement. Le terme de « devoir de mémoire » qui s’impose partout, et notamment dans la presse, me semble d’une stupidité et d’une barbarie ahurissante ; la pédagogie, c’est le contraire de la subjectivation. Subjectivation et invention, c’est pareil ; invention, c’est l’autre nom de la subjectivation.
D’une façon générale, une des plus grandes difficultés de l’analyse, c’est de permettre au patient de s’approprier sa cure ; que son analyse lui appartienne. Se trouve ainsi constitué un espace où, si l’on veut, le patient peut entamer un dialogue avec son Idéal du Moi qui s’y déploie. Mais je soulignerai surtout la libération des forces du patient quand on assiste, au coeur de cet espace, à son utilisation de l’analyste pour oser. C’est quelque chose de tout à fait singulier ; c’est singulièrement que le patient se mesure aux lois qui l’habitent. C’est vous dire mon extrême méfiance. Trop souvent, la psychanalyse est ravalée à la « bonne loi » et on se fait fort de l’importer dans la vie du patient. Je dis que j’ai suffisamment d’expérience pour savoir que cette déviation est fréquente, sinon banale. C’est ça la psychothérapie dans le mauvais sens du terme. On finit par mettre son savoir, toujours plus ou moins narcissique, au-dessus des savoirs du patients, de ses pensées. Et au-dessus du travail analytique proprement dit.
J’ai été extrêmement ému quand une patiente a pu me dire dernièrement : « Je ne sais pas si ce sont les mots qu’il faut, mais c’est ceux-là que j’ai trouvés. » Vous ne pouvez pas savoir quelle victoire, quelle mutation ça peut être pour cette personne dont le Moi était si rabougri. Avoir pu oser dire ça à son psychanalyste, en quelque sorte quoi qu’il en pense, lui qui est supposé se tenir du bon côté des mots. Bien sûr, il y a une loi là-dedans, mais elle n’est pas commune.
Si j’ai été suffisamment clair, il me semble que tout cela dessine une sorte de strate basique dans une analyse. Il s’agit de trouver son chemin dans le désert, au coeur du désert, et se faire l’analyste de sa propre humanisation. Ceci s’apparente à l’acte d’écrire avant le travail d’écriture, quand écrire est création de la lettre, de la page, ou plus exactement de la lettre comme page. C’est, je crois, une autre façon de dire ce que Lacan avance dans Lituraterre : « L’écriture est dans le réel le ravinement du signifié, ce qui a plu du semblant en tant qu’il fait le signifiant. » Le palimpseste est de structure. Le psychanalyste est alors celui qui prend la main de quelqu’un pour l’accompagner et lui permettre d’apprendre de quoi est fait le rien, le noir, le sans-nom qu’il redoute tant ; peut-être alors est-il comme un chaman ou un Indien, celui qui sait lire dans les choses. Pouvoir faire confiance à quelqu’un qui sait faire ça n’a pas de prix, et ce n’est pas un travail d’apprendre les lois dans les livres, c’est un fruit de l’expérience. Je veux le dire avec force : il faut quand même bien comprendre sur quelle déchirure, sur quelle souffrance, sur quels renoncements repose le moindre concept lacanien. Le comprendre, c’est savoir ce savoir forgé par Lacan comme un savoir vrai – et c’est avec le savoir vrai que vous entendez. Le reste ne vous sert absolument à rien, sinon à rester sourd. C’est pourquoi je rappelle sans cesse d’où venait à Lacan son savoir, de quelle exigence il portait la trace : celle de l’expérience. L’expérience mise en mots. Comme lui-même le disait à propos de Freud : « Le savoir de Freud, c’est-à-dire son expérience. » Autrement dit, c’est un savoir signé.
Grignon, O., Avec le psychanalyste l’homme se réveille, Eres, 2017, pp. 61 – 64

